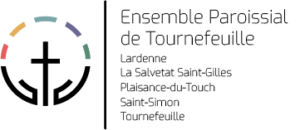Homélie du Père Justin, VII Dimanche du TO, Lc 6,27-38 (Année C)
Chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit d’aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, de bénir ceux qui nous maudissent…
Il n’est pas difficile de se représenter ce que serait le discours inverse : Faites du bien à vos amis, haïssez vos ennemis, bénissez ceux qui vous bénissent, maudissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du bien, faites du mal à ceux qui vous font du mal, etc… Cependant, que se passe-t-il si nous agissons de la sorte ?
Nous entrons dans un cercle à l’intérieur duquel nous faisons du bien à nos amis en échange de quoi nous attendons du bien de leur part, tout comme nos amis nous font du bien en attendant du bien de notre part. Nous échangeons des faveurs, nous formons un groupe d’amis par opposition avec un groupe d’ennemis. Les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Et nous arrivons à ce que nous appelons du clientélisme.
Et tout ce système est mis en place pour qu’un groupe domine sur un autre groupe et pour que les groupes les plus puissants se partagent des avantages. On entre dans ces groupes pour bénéficier de ces avantages, en général. Sommes-nous libres de cette façon ? nous sommes moins libres que jamais.
Avant tout le Seigneur nous délivre, il nous libère de ces cercles, celui des amis et celui des ennemis. Il nous donne et redonne la liberté des fils et des filles de Dieu. Mais il ne nous donne pas cette liberté dans une sorte de rébellion envers notre société ou de destruction de cette société. Son modèle de société est en contraste radical avec ce que le monde propose, et cependant il ne détruit rien, il nous en fait sortir par le haut. Il nous donne de transfigurer notre vie personnelle et sociale.
Nous continuons à faire du bien à nos amis mais cela n’est plus l’essentiel, l’accent est mis sur le fait de faire du bien tout autant à nos ennemis, pour briser les cercles, sortir des boucles d’aliénation et de haine réciproque. Le Seigneur nous rend libre, il nous rend notre dignité – c’est très important de le percevoir.
Vous avez entendu ce qu’il nous dit : A qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre. C’est un homme libre qui parle, et qui affirme notre liberté et notre dignité. C’est important à comprendre parce que souvent on entend ces paroles dans le sens contraire. Si je reçois une gifle et tends l’autre joue, non seulement ma dignité est en péril mais celle aussi de celui qui me frappe, je l’invite à me frapper une seconde fois…
Mais ça n’est pas ainsi qu’il faut percevoir cet enseignement. Il s’agit pour nous de sortir de la boucle de la violence et de donner l’opportunité à notre voisin de sortir lui aussi de cette boucle par la même occasion. J’affirme ma dignité et sa dignité, ma liberté et sa liberté.
Si on veut mieux comprendre cet enseignement nous pouvons nous souvenir de ce que fait le Seigneur durant son procès, tel qu’il est relaté dans l’Évangile de Jean. Un soldat le frappe sur la joue et le Seigneur bien entendu ne lui rend pas la gifle – pas seulement parce qu’il est attaché ! –mais il lui dit : Si j’ai mal agi, dis-moi en quoi j’ai mal agi ; mais si j’ai bien agi, pourquoi me frappe-tu ? Avec cette question le Seigneur ne répond pas à la violence par la violence – donc il s’en libère lui-même et du coup il donne la possibilité au soldat de sortir de la boucle de la violence lui aussi, il partage cette liberté avec lui. C’est tout ce dont il s’agit dans les paroles de Jésus – même si elles prêtent facilement à confusion.
Les paroles de Jésus sont aussi à comprendre dans le contexte de la noblesse du comportement des fils de Dieu. Cette noblesse nous a été communiquée dans notre création et plus encore dans notre rédemption. Nous voyons cette noblesse chez David, dans la première lecture – dans toute l’histoire de David ce qui nous frappe c’est la noblesse de son comportement. Il est pécheur mais il est noble dans son tempérament et sa noblesse le rapproche d’une justice plus haute, proche de Dieu lui-même. Il refuse de tuer Saul par respect pour lui-même et pour Saul, il montre à Saul qu’il reconnait sa dignité d’élu de Dieu. Mais chaque personne est créée à image de Dieu, est fils et fille de Dieu et a une dignité infinie – chacun de nous est l’élu de Dieu.
Le Seigneur dans cet évangile ne nous donne pas seulement une éthique, une morale nouvelle, plus haute. Mais il nous communique sa propre vie, la vie de Dieu lui-même, de ses fils et de ses filles, la relation qu’ont entre elles les personnes de la Trinité.
Cet évangile nous fait penser à Marie dans l’Annonciation, elle reçoit la visite de l’ange, elle prend une décision personnelle librement et elle dit : Voici la servante du Seigneur et elle devient mère de Dieu. C’est cela qu’elle a perçu et ressenti, une vie nouvelle qui est un amour inconditionnel pour toute l’humanité, pour chaque être, et qui nous confère une dignité extraordinaire. C’est cet amour gratuit, sans condition qu’elle a accueilli dans son sein pour le donner au monde.
C’est cette vie nouvelle que le Seigneur nous demande d’accueillir nous aussi pour transfigurer toutes nos relations, c’est une bonne mesure qui sera versée dans notre sein – une vie nouvelle. Notre justice sera reconnue par Dieu et tôt ou tard par les hommes, parce qu’elle vient de Dieu et que tous en réalité aspirent à elle.