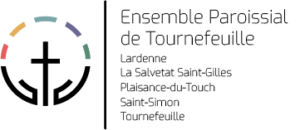Homélies des messes
Homélie du Père Clément, Ier dimanche de Carême – Année C
Vaincre la tentation avec le Christ, le Nouvel Adam/Le désert, école de la foi
Frères et sœurs bien-aimés,
Nous voici entrés dans le grand combat spirituel du Carême. Quarante jours, comme Jésus au désert. Quarante jours, comme Moïse sur le mont Sinaï. Quarante jours, comme le peuple hébreu explorant la Terre promise. C’est un temps de conversion, de combat spirituel, et de renouveau intérieur.
Le Carême, c’est aussi un désert, un temps où Dieu nous conduit pour nous purifier, nous fortifier, nous rendre plus vrais. Mais c’est aussi le lieu de la tentation.
L’Évangile de ce jour (Lc 4,1-13) nous montre que même Jésus a été tenté. C’est un message fort : la tentation fait partie du combat spirituel. Aucune âme n’y échappe. Saint Augustin disait déjà que : « Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l’épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve ; personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut combattre s’il n’a pas rencontré l’ennemi et les tentations ».
Un jeune homme demande un jour à un moine : « Comment puis-je devenir un saint sans être tenté ? »
🔸 Le moine lui répond : « C’est impossible ! Même les anges ont été tentés au Ciel ! Ce n’est pas la tentation qui est un péché, c’est d’y céder ! »
Aujourd’hui, l’Évangile (Lc 4,1-13) nous plonge dans la lutte entre Jésus et le diable. Trois tentations, trois ruses du Malin, trois manières de tromper nos âmes. Mais Jésus nous enseigne la victoire !
- La tentation : Une arme du diable pour détruire nos âmes
🔹 Le diable ne nous attaque pas n’importe quand. Il vient dans nos moments de faiblesse.
Jésus a faim après quarante jours de jeûne. C’est le moment que Satan choisit pour l’attaquer !
Première tentation : La tentation du pain
« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain ! » (Lc 4,3)
C’est la tentation du matérialisme, celle qui nous fait croire que l’essentiel est d’avoir, de posséder, de consommer.
Jésus répond par la Parole de Dieu : ✠ « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Dt 8,3).
Saint François d’Assise disait : « Ce que nous possédons finit par nous posséder ! »
➡ Aujourd’hui, nous avons tout : technologie, confort, nourriture… mais nos âmes sont souvent vides ! La vraie nourriture, c’est Dieu.
Deuxième tentation : La tentation du pouvoir et du succès
« Je te donnerai toute la gloire de ce monde si tu te prosternes devant moi » (Lc 4,6-7).
⚠ C’est la tentation de la réussite facile, sans effort, sans fidélité à Dieu.
Jésus répond :✠ « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul rendras un culte » (Dt 6,13).
Un jour, un jeune homme demande au diable : « Que me donneras-tu si je te sers ? »
🔸 Le diable répond : « Le pouvoir, l’argent, la gloire… mais en échange, je veux ton âme ! »
➡ Beaucoup de gens, aujourd’hui, se prosternent devant l’argent, le succès, la facilité… mais ils perdent Dieu !
Troisième tentation : La tentation de l’orgueil spirituel
« Jette-toi du Temple, et les anges te sauveront ! » (Lc 4,9-11)
C’est la tentation de mettre Dieu à l’épreuve, de chercher des signes au lieu d’avoir la foi.
Jésus répond :✠ « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu » (Dt 6,16).
Saint Augustin disait : « Dieu ne veut pas être testé, mais aimé ! »
➡ Parfois, nous disons à Dieu : « Si tu m’aimes, prouve-le-moi ! Fais un miracle ! »
Mais la vraie foi, c’est de lui faire confiance sans exiger de preuves.
- Trois armes pour vaincre la tentation
Jésus nous enseigne comment triompher du Malin :
- La Parole de Dieu : Une épée spirituelle
Jésus répond à chaque tentation par un verset biblique.
Saint Paul nous dit : « Prenez l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu » (Ep 6,17).
➡ Lire la Bible chaque jour, c’est apprendre à se défendre spirituellement ! - La prière et le jeûne : Une force intérieure
« Ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière et le jeûne » (Mc 9,29).
➡ Le jeûne nous détache du superflu et nous recentre sur Dieu. - L’adoration et la fidélité à Dieu
Jésus refuse de se prosterner devant Satan.
Saint Padre Pio disait : « Plus un homme adore Dieu, plus il devient fort contre le diable. » - La victoire avec le Christ
Frères et sœurs, le combat spirituel est une réalité, mais nous ne sommes pas seuls.
Jésus a vaincu le Malin pour nous !
Saint Paul nous l’assure dans la deuxième lecture (Rm 10,8-13) :✠ « Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. »
🔹 Notre victoire est dans notre foi et notre fidélité au Christ.
Pour conclure…Carême, chemin de conversion….
Ce premier dimanche de Carême nous rappelle que le désert est un passage nécessaire pour grandir dans la foi. Nous ne devons pas fuir la tentation, mais apprendre à la vaincre avec le Christ.
Trois résolutions concrètes pour cette semaine :
1️⃣ Lire chaque jour un passage de l’Évangile pour fortifier notre âme.
2️⃣ Vivre un vrai moment de prière quotidienne avec cœur.
3️⃣ Faire un petit sacrifice pour nous détacher du superflu et grandir en liberté intérieure.
Prions avec Saint Augustin :
Seigneur mon Dieu,
Quand je vacille, soutiens-moi.
Quand je doute, éclaire-moi.
Quand je suis tenté, fortifie-moi.
Tu es ma lumière, mon refuge et ma force.
Sans Toi, je ne peux rien,
Mais avec Toi, je peux tout.
Par ta Parole, repousse l’ennemi,
Et que ton amour soit mon bouclier, Amen ! (Saint Augustin)